Fiche de lecture : Grégoire Chamayou - La société ingouvernable
L’auteur :
Grégoire Chamayou est un philosophe français né en 1976. Il est agrégé, normalien (école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud), et chargé de recherche au CNRS, rattaché à l’IHRIM de l’ENS Lyon. La société ingouvernable est son quatrième ouvrage. Ses objets de recherche semblent s’inscrire dans une démarche proche des études foucaldiennes : comment incorporer la discipline dans les corps de la Renaissance au XIXème siècle, la chasse à l’homme ou encore des analyses sur l’émergence des drones dans les théories de la guerre. Son dernier ouvrage en date, Du libéralisme autoritaire (Zones, 2020) semble être une prolongation du travail réalisé dans La société ingouvernable. Néanmoins dans ce livre, il s’intéresse plus aux juristes (Schmitt, par exemple) qu’aux théories de la firme et aux XXème et XXIème siècle. On peut noter une similitude avec les travaux de Dardot et Laval mais aussi de Barbara Stiegler concernant l’effort que font les philosophes et les sociologues pour tenter de comprendre les motivations du système économique et des politiques des Etats depuis le travail de Marx et Engels.
Résumé général du livre :
Dans cet ouvrage, Grégoire Chamayou effectue un travail philosophique inspiré de la généalogie et avec une méthode du commentaire de texte. Dès l’introduction, il explicite sa méthodologie. En partant d’un constat, l’indiscipline de la classe ouvrière, que font des auteurs dit « de gauche » comme « de droite », à savoir, par exemple Foucault et Huntington. Ce constat entraîne une réaction de la classe dirigeante, des intellectuels, des grandes entreprises, bref, de ceux qui détiennent les moyens de production, qu’ils soient matériels ou intellectuels. Le livre puise ses sources dans des auteurs conservateurs, des rapports, mais aussi des faits sociaux. On peut identifier une démarche constante de la part des propriétaires des moyens de production : comment légitimer et orchestrer la domination et l’expansion du capitalisme ?
En effet, le livre de Grégoire Chamayou est une longue récension de toutes les techniques mise au point pour légitimer un mode de production, mais aussi contrer les attaques, mener des offensives. De plus, l’auteur cherche à comprendre l’idéologie qu’il finir par nommer le libéralisme autoritaire. Il montre comment l’intérêt économique et les considérations politiques des citoyens sont irrémédiablement contradictoire. La légitimation du capitalisme n’étant pas un affrontement uniquement entre deux camps, au sein même des partisans du capitalisme, des conflits et des désaccords voient régulièrement le jour. Loin d’être un livre militant, le livre de Grégoire Chamayou reste impressionnant par sa rigueur méthodologique : chaque argument, texte et idée est sourcé. L’auteur tente une mise à distance, mais prend parfois parti.
La structure du livre :
La société ingouvernable est divisée en 8 parties :
Une introduction, 6 parties contenant 26 chapitres et une conclusion.
Introduction : l’introduction sert à introduire la situation des années 1970, et à expliciter le travail, l’intention et la méthodologie utilisé par le philosophe.
Partie 1 : Les travailleurs indociles.
Dans cette partie, l’auteur montre les différentes formes d’indiscipline ouvrière qu’on relatait dans les années 1970. Certains ouvriers travaillaient une semaine, partait et ne venaient pas chercher leurs paies. Ou alors justifiait le fait de travailler uniquement 4 jours au lieu de 5, parce que s’ils travaillaient moins, ils ne pourraient pas subvenir à leur besoin. De plus, les travailleurs avaient conscience d’être en mesure de peser dans les décisions prises par les directions, puisque Chamayou évoque l’exemple d’une chaîne de production où des moteurs ont été sabotés par les travailleurs parce qu’ils considéraient que les ingénieurs avaient conçue un modèle peu fiable. L’exemple le plus frappant et qui illustre en partie ce qui sera mis en place par la suite et celui d’un inventaire, où des travailleurs bricole un système plus efficace que le modèle standard d’inventaire. Néanmoins, cette manière de faire ne convient pas aux managers, et sera donc supprimé. Il faut comprendre que deux types de management ont été élaboré pour répondre à cette indiscipline, un management plutôt réformiste qui consistaient à donner plus de responsabilité aux travailleurs (l’exemple de l’usine de croquette) et un management disciplinaire, où on augmenta les cadences, où la discipline était omniprésente. Ce dernier engendra une grève très dure, et de vives réactions de la part des travailleurs.
Partie 2 : Révolution managériale
On peut définir le managérialisme comme le fait de se préoccuper par le bien de l’humanité mais en disciplinant les ouvriers. Chamayou propose de définir par le terme « managérialité » la gouvernance qui opérait avant le tournant néolibéral. Ce terme est à mettre en contraste avec la notion foucaldienne de « gouvernabilité » qui est élaboré pour répondre à : « comment introduire l’économie à l’intérieur de l’Etat ? » (à la page 49). Dans cette partie, Chamayou tente de localiser les mouvements et la place du pouvoir dans l’entreprise. Pour contrôler les entreprise, le philosophe affirme qu’il existe un marché du pouvoir. Il existe aussi une gouvernance, impersonnelle, celle du marché :
« Dans cette apologie rénovée de l’économie de marché, le primat de la valeur actionnariale est encensée comme un principe de méta-gouvernement catallarchique efficient, dogme d’une nouvelle foi, où le nomos du marché convertirait spontanément le chaos capitaliste en régularité ordonné. La véritable raison d’être de la Bourse et du profit, « son ultime justification » écrivait le néolibéral français Henri Lepage en 1980, est d’abord et avant tout d’être un instrument de ‘régulation’ sociale ». La « légitimité sociale du profit capitaliste », affirma-t-il, se fonde sur les « principes de régulation cybernétique de l’économie de marché ». (p. 67)
Ce que montre l’auteur à la fin de cette deuxième partie, c’est qu’on a un pouvoir managérial qui est subordonné à un pouvoir actionnarial. La verticalité du pouvoir opère donc en plusieurs temps et avec des agents différents.
Partie 3 : Attaque sur la libre entreprise.
Il s’agit tout d’abord de définir l’entreprise comme un gouvernement privé. Et de localiser les lieux du pouvoir au sein même du management. Ce management est une forme de pouvoir biopolitique puisqu’il gouverne les salariés dans l’entreprise mais aussi en dehors, en s’immisçant dans la vie des gens. Mais, il y eu de vives réactions et des militants s’opposèrent aux grandes entreprises. Les perturbateurs des affaires préoccupèrent de plus en plus les têtes pensantes du camp conservateurs, qui enclenchèrent une guerre des idées. Ils créèrent des éléments de langage, sophistiquèrent leur rhétorique, pour forger une langue qui les avantageraient à chaque fois. Les entreprises commencèrent alors à se préoccuper de leur réputation et a soigner leur image pour répandre l’illusion de leur responsabilité face aux enjeux socio-économiques. Néanmoins, les intellectuels réactionnaires flairèrent la difficulté : « Pourra-t-on continuer longtemps à défendre le capitalisme par des valeurs non-capitalistes ? La contradiction est-elle tenable ? » (P. 92)
Ici, nous devons préciser un point. La méthodologie de Chamayou, éprouve la véracité des thèses des intellectuels conservateurs pou réactionnaire en cherchant systématiquement les contradictions internes à leurs discours. Cette méthode semble être redoutable pour mettre à mal des justifications qui, à première vue, semblent être incontestable et bien fondée.
On présente souvent l’économie comme quelque chose de spontanée et d’éternelle, mais ce que montre Grégoire Chamayou, c’est qu’au contraire, là où les intellectuels de la réaction argumentent pour une vision du marché spontanée, autorégulatrice, etc… on retrouve au contraire des intentions, des stratégies, des analyses et des projets qui ont été mis en place de manière tout à fait consciente. Un des aspects les plus questionnant de ces théories est que l’entreprise et les théories du pouvoir y sont élaboré en se préoccupant uniquement de l’économie, du marché, des managers, des actionnaires mais jamais des travailleurs. Pourtant ces derniers sont considérés comment étant la source du danger qui pèsent sur les entreprises et sur l’économie capitaliste. A ce propos, les analyses et la réaction qui est décrite dans ce livre est justement mise en œuvre parce que les intellectuels conservateurs prévoyaient la fin du monde de l’entreprise si les choses continuaient à aller ainsi.
« Il faut avoir une théorie. Oui, mais pourquoi ? La réponse évidente, la plus fréquemment donnée, quoique insuffisante, se formule en termes de justification. Une domination nue ne tient pas. Il lui faut des avocats » (p. 104)
« Leur toute première cible était le champ académique. Opérer sa reconquête. La reconfiguration des modes d’interrogation savants de l’économie s’est accompagnée depuis les années 1970 d’inlassables efforts d’éviction, discursive et institutionnelle, des « hétérodoxes ». S’assurer la maîtrise de ce qui est intellectuellement formulable. Exclure l’adversaire de la capacité académiquement sanctionnée de « dire vrai ». » p. 105
Un peu plus loin, au chapitre 13, l’analyse de la responsabilité limitée est révélatrice d’une lutte des classes effectives. En effet, la responsabilité limitée permet aux actionnaires de gagner de l’argent quand l’entreprise fait des profits mais de ne pas en perdre quand cette dernière traverse une mauvaise période. Ici, on a une responsabilité qui est à géométrie variable, et qui s’inverse bien souvent pour la classe ouvrière puisque ces derniers peuvent être licencié ou ne pas toucher de prime quand l’entreprise va mal. Les intérêts de classe sont ici révélés.
Partie 4 : Un monde contestataire
C’est une des parties les plus instructive concernant l’élaboration de technologie de pouvoir au sein de l’entreprise. Face aux contestations et à l’activisme qui s’abat sur des grandes firmes telle que Nestlé, des savoir-faire, des stratégies, etc… vont voir le jour. Non pas pour répondre aux exigences de la société civiles mais pour contre-attaquer, réfuter, et faire perdre le camp d’en face. Une véritable typologie des militants et une méthode de neutralisation de ces derniers est élaboré. Pour se débarrasser des contradicteurs, les grandes entreprises, après avoir été désespéré et d’aller jusqu’à embaucher un psychanalyste, s’en remette aux services et conseils d’ancien militaire. Le but est de neutraliser l’ennemi et de conquérir l’opinion publique. On fait du contre-activisme qu’on couple aux vieilles théories des relations publiques élaboré par Edward Bernay. Aussi, il a été nécessaire d’effectuer un travail épistémique, en renvoyant les anciennes catégories de la philosophie politique dans les cordes. Une fois ces notions devenues surannées, les idéologues se mirent à produire un discours qui servait la réalité de l’entreprise et non pas de la société civile.
Voici la typologie mise en place par Pagan :
« 1° Les radicaux. Eux « veulent changer le système », ils « ont des mobiles socio-économiques ou politiques sous-jacents », sont hostiles à l’entreprise en elle-même, et « peuvent se montrer extrémistes et violents ». Avec eux, rien à faire.
2° Les opportunistes. Ceux-là cherchent « de la visibilité, du pouvoir, des troupes, voire, dans certains cas, un emploi ». « La clé pour traiter avec les opportunistes est de leur fournir au moins l’apparence d’une victoire partielle. »
3° Les idéaliste. Ces gens-là « sont, d’ordinaire, naïfs […] altruistes. Ils suivent des principes éthiques et moraux ». Le problème avec eux, c’est qu’ils sont sincères, et, de ce fait, très crédibles. Sauf qu’ils sont aussi très crédules : « Si on peut leur démontrer que leur opposition à une industrie ou à ses produits entraîne un dommage pour d’autres et n’est pas éthiquement justifiable, alors ils seront obligés de changer de position. »
4° Les réalistes. Eux, c’est du pain bénit : « Ils peuvent assumer des compromis ; ils veulent travailler au sein du système ; un changement radical ne les intéresse pas ; ils sont pragmatiques. » »
Cette description grossière des milieu militants n’a pas vous vocation de décrire avec précision la réalité, mais plutôt une réalité : celle au service de la contre-attaque. On dresse une typologie afin de pouvoir diviser les militants entre eux, et désarmer la cause de sa légitimité.
« Tandis que le managérialisme éthique se proposait de gouverner l’entreprise dans les formes d’un despotisme éclairé, cette nouvelle managérialité stratégique entend gouverner le monde social qui l’entoure en y déployant un art de « la manipulation de l’environnement externe -physique, social et politique- destinée à le rendre plus réceptif aux activités de l’entreprise ». » P.137
Pour rendre ses techniques de neutralisation efficace, l’entreprise a besoin de redéfinir sa théorie des relations de pouvoirs, en inventant la théorie des parties prenantes. On retrouve quelque chose d’assez proche de Habermas ici, où les agents sont identifiés comme des êtres avec des intérêts qu’ils défendent. Cette théorie est élaborée pour neutraliser les agents qu’on considère comme ennemis. Le choix qui s’impose à eux est : soit vous êtes légitime et inoffensif, soit vous êtes illégitime mais offensif. De plus, la partie prenante n’existe qu’en dehors du champ économique, ce qui est la condition première à la neutralisation des adversaires, puisque les revendications de ces dernières n’ont plus d’impact sur les intérêts du capital.
« Il y a donc dissonance entre les critères de la reconnaissance morale et ceux de l’identification stratégique. Un groupe considéré comme partie prenante au point de vue stratégique, pourra ne pas l’être au point de vue éthique et inversement » P. 148
« Entre économie et éthique, il y a un troisième pôle, stratégique, qui opère la médiation entre les deux autres » P.152
Partie 5 : Nouvelle régulation
Avec l’émergence des multinationales, le droit évolue : « Se posait en conséquence de plus en plus clairement la question des limites des législations nationales et d’une régulation elle-même internationale des multinationales. » P.157 On se doute bien que la question de la régulation n’arrangeait pas les multinationales si cette dernière n’était pas en faveur du capitalisme et des entreprises. On voit donc émerger une doctrine dorénavant bien connue : inciter plutôt que contraindre. C’est ce que résume le concept de soft law, que Chamayou préfère définir comme low law, puisque sous couvert de bonne volonté, les firmes pouvaient au contraire continuer de mal se conduire. En fin de compte, les lois mises en place, seront rédigé par ceux qui ont possèdent les moyens de production et donneront lieu à des low law pour l’intérêt du capital et des hard law pour les travailleurs. Faible avec les forts, forts avec les faibles.
Avec cela, on tente de définir les impacts de l’activité capitaliste par les notions de coûts / bénéfices. Cette nouvelle régulation donnera naissance aux lois « pollueurs payeurs », par exemple, mais serviront surtout les entreprises pour démanteler l’Etat social. Un des phénomènes intéressant que provoqua cette notion de coûts / bénéfices est que les économistes tentèrent de donner un prix à la vie, pour éviter de devoir se confronter aux enjeux politiques que crée les problématiques propres aux activités capitaliste (pollution, exploitation, pauvreté, etc…). Mais Chamayou démontre qu’on ne peut pas donner de prix à la vie, et qu’une fois de plus les économistes néo-libéraux sont face à une contradiction qui est interne à leur propre théorie. Il faut plutôt chercher une fonction plus fondamentale de l’analyse coûts / bénéfices : « en posant l’analyse coûts / bénéfices comme principe de décision on cherchait à modifier le régime de la preuve en faveur de l’entreprise. C’était une offensive lancée sur le double terrain, épistémologique et judiciaire, de la preuve. » P.171
A propos de l’estimation monétaire de la vie : « La vérité est qu’il n’en existe aucune. Et ceci non pas du fait de difficultés techniques, de biais méthodologiques ou d’erreurs de calcul, mais parce qu’il n’y a pas de juste prix de la vie, elle dont la suppression ne s’échange contre rien sans une perte irréductible. La question, autrement dit, est nécessairement aporétique. Or ceci, il faut le souligner, fait intégralement partie du défi lancé par les dérégulateurs. C’est une tactique de sphinx : vous mettre en position, soit de répondre à une question insoluble soit de sauter dans le vide – nul autre choix. » P.176
De plus, Chamayou caractérise le capitalisme comme une économie de la décharge : l’écologie est disqualifiée par une exclusion, elle est considérée comme une externalité, une négativité qui ne compte pas et qui ne peut pas compter sans mettre en difficulté l’idéologie capitaliste. Par ailleurs, et à propos de l’écologie, les grandes firmes renvoyaient la balle dans le camp des individus et de leur responsabilité. Par exemple, après avoir œuvré pour un conditionnement des sodas en canette et non plus dans des contenant consignable, des compagnies amorcèrent des campagnes de culpabilisions des consommateurs en leur incombant de trier leurs déchets alors que les consignes étaient bien plus efficaces en terme d’écologie politique. Enfin, il est très difficile pour un individu de faire un choix responsable quand on prend en compte la complexité d’une société. Mais tout cela était bien pensé : il ne fallait pas changer le mode de production, mais mettre en œuvre des implications micropolitiques, ce que nous verrons dans la dernière partie.
Partie 6 : L’Etat ingouvernable
Cette dernière partie revient sur la filiation intellectuelle d’Hayek à Schmitt, et démontre que même si Hayek exprime un désaccord sur l’alliance de Schmitt au nazisme, Hayek a pourtant de facto toujours pris position pour des régimes autoritaires : le Chili de Pinochet, l’Afrique du Sud de l’apartheid, etc… Néanmoins Hayek ne souhaite pas que le néo-libéralisme s’impose de manière virulente comme au Chili. Même si en dernier recours, il approuve ce type de stratégie. Pour le néo-libéralisme, tout d’abord, c’est la démocratie qui est totalitaire, parce qu’elle empêche la liberté d’entreprendre. Chamayou affine la notion de libéralisme autoritaire dans cette dernière partie. De plus, il montre comment la filiation entre Hayek et Schmitt est bien plus préoccupante et problématique que ce qu’Hayek se refuse à admettre.
Concernant la politique économique du néo-libéralisme autoritaire, on apprend que la rigueur budgétaire est une des pensées de ce dernier. Néanmoins, pour Chamayou, ce dernier se caractérise plus par une réduction du budget de l’Etat que d’une rigueur budgétaire. Les techniques pour acquérir le consentement de la population sont assez similaires à celle décrite auparavant : proposer une réforme qui touchera les générations futures, faire croire à une alternative possible, à la prise en compte de compromis, etc… Le néolibéralisme est une forme d’interventionnisme qui met à mal les infrastructures de l’Etat social et privilégie le marché.
Les micropolitiques que les intellectuels néolibéraux élaborent n’ont rien à voir avec la pensée de Deleuze et Guattari.
« Que recouvre cette « micropolitique » néolibérale ? Pirie la définit de façon assez absconse comme « l’art de générer des circonstances dans lesquelles les individus seront motivés à préférer et à embrasser l’alternative de l’offre privée, et dans lesquelles les gens prendront individuellement et volontairement des décisions dont l’effet cumulatif sera de faire advenir l’état de choses désirée. » P.249
Ici, on voit bien l’intérêt de mettre à mal un service public : si la compagnie publique n’est pas dans un état de marche optimale, les usagers s’orienteront vers les compagnies privées, ce qui affaiblira le publique et légitimera la privatisation.
Conclusion :
Ici, nulle théorie du complot. Chamayou démontre avec des textes à l’appui, que le capitalisme possède ses propres militant. Des alliances se forment pour réagir aux revendications de la société civile. Loin d’être une offensive menée de manière unitaire, les militants du capitalisme s’efforce d’élaborer des théories et des techniques qui doivent répondre à la contradiction, neutraliser ses adversaires et produire un discours de légitimation de l’économie en pacifiant les rapports sociaux, et en conquérant le consentement des masses.
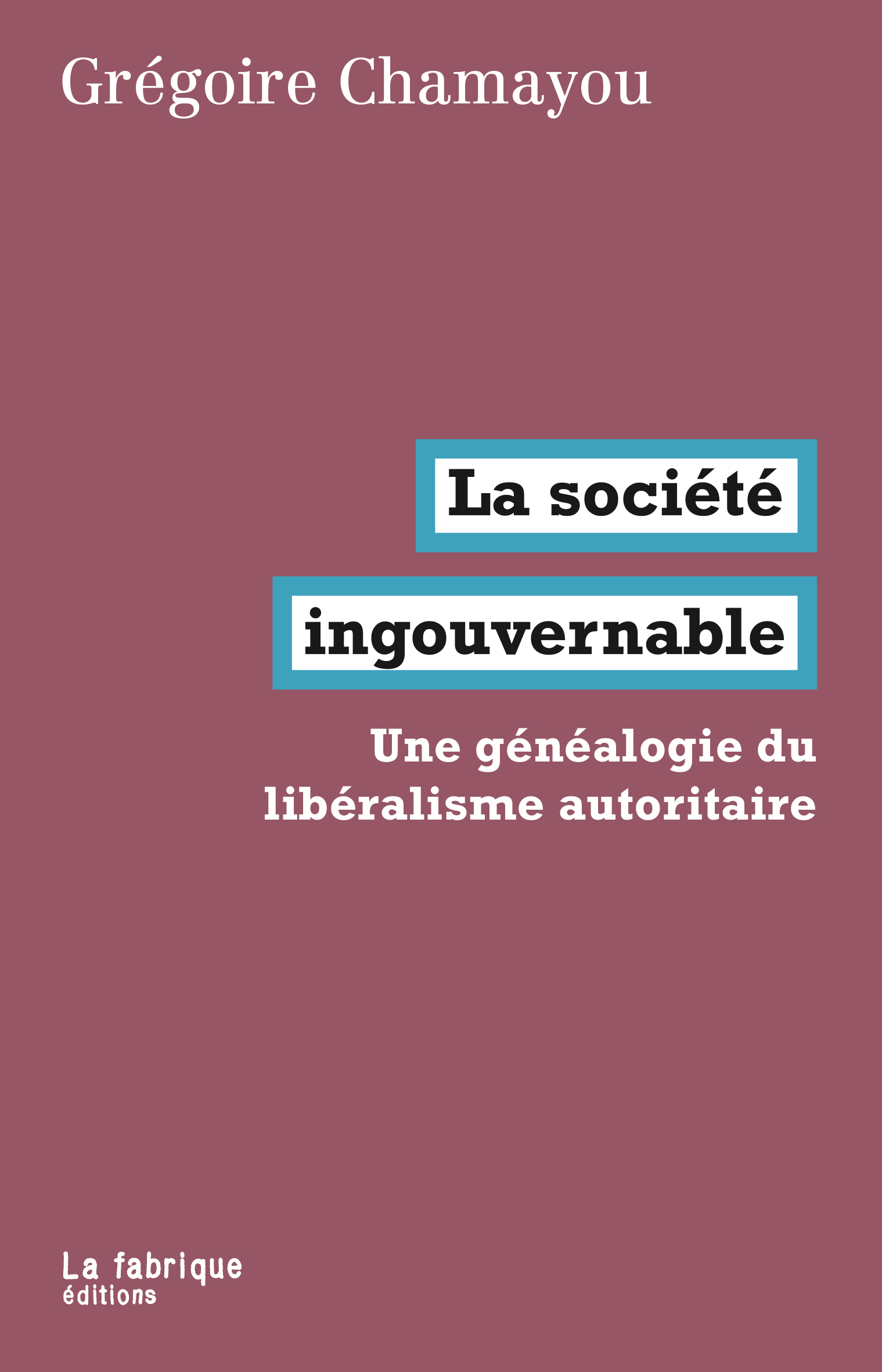
Commentaires
Enregistrer un commentaire